ARCHITECTURES MATERIELLE ET SYSTEMES D’EXPLOITATION
Traitement automatique de l’information
I La machine de
Turing : un modèle théorique automatisant tout ce qui est calculable.
Une machine de Turing est un automate imaginaire muni d’un seul programme M (sous la forme d’une table de transition entre états) et pouvant lire et écrire des caractères sur un ruban d’une longueur illimitée.
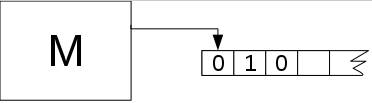
Ses défauts :
· si elle était réalisée physiquement, elle serait très lente, car le niveau très élémentaire de ses opérations entraîne une expression extrêmement longue des algorithmes les plus simples.
· Il faudrait une machine pour chaque type de calcul.
Pour éviter la multiplication de machines de Turing pour réaliser des opérations multiples ou complexes M, M’, M’’… Turing imagine la machine universelle, qui reproduit le fonctionnement de sa machine sur le ruban lui-même.
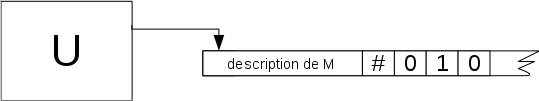
Tout algorithme (procédé systématique de calcul) peut être réalisé par une machine de Turing : c’est la « thèse de Church-Turing », du nom des deux mathématiciens Alonzo Church et Alan Turing. Cette thèse de 1936 est indémontrable par essence en l’absence précisément d’une définition formelle d’un algorithme, mais elle n’est pas contredite à ce jour.
Ainsi les programmes deviennent des données comme les autres.
Une machine de Turing est un instrument purement conceptuel.
Une contribution cruciale d’Alan Turing est la preuve de l’existence d’une machine de Turing dite « universelle ». Si on fournit à cette dernière la table de transition d’une machine de Turing particulière, autrement dit le programme d’un algorithme, elle est capable de reproduire le fonctionnement de cette machine, donc d’exécuter le programme en question.
II Architecture de
Von Neumann : la réalisation concrète d’une machine universelle.
Il faut attendre 1945 pour qu’une machine universelle utilisant ces principes soit construite. On la doit à John Von Neumann. Dans ce modèle le stockage en mémoire et le processeur sont clairement distincts.
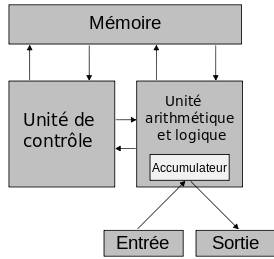
L'ENIAC (acronyme de l'expression anglaise Electronic Numerical Integrator And Computer), est en 1945 le premier ordinateur entièrement électronique construit pour être Turing-complet. Il peut être reprogrammé pour résoudre, en principe, tous les problèmes calculatoires.

Cette architecture se retrouve encore aujourd’hui dans nos PC, smartphones, tablettes…
Se pose la question de la stabilité d’un système où les programmes, traités comme des données sont parfois modifiés et placés en mémoire.
III Le système
d’exploitation
La stabilité d’un tel système est assurée par la création
d’un système d’exploitation, qui est un ensemble de
programmes qui dirige l'utilisation des ressources d'un ordinateur par des
logiciels applicatifs.
Le système
d’exploitation est l’intermédiaire entre les ressources et le processeur, il gère en particulier les actions lancées simultanément, grâce
à l’horloge qui chaque milliseconde hiérarchise les tâches à accomplir.
Il est devenu indispensable, en
particulier depuis les ordinateurs multi utilisateurs, afin de :
·
Filtrer les
utilisateurs
·
Gérer les droits des
utilisateurs
·
Protéger le service ou
l’utilisateur
Un autre aspect du système d’exploitation est la gestion
de la mémoire. Il permet de savoir à quels endroits sont stockées physiquement les
informations sur le disque dur sous forme de polarités.
En effet, il organise la mémoire en plusieurs
millions de secteurs de 512 octects ou de kio .
On peut donc écrire des nombres compris entre 0 et 232768-1 dans un
secteur (32768=24*1024).
Les informations sont dans un ou plusieurs secteurs.
Cependant si des informations avaient des tailles inférieures à 4ko, en écrire
une par secteur gâcherait de l’espace. C’est pourquoi dans chacun de ces
secteurs, une partie est réservée à la façon dont est organisée
le secteur. Ainsi on peut juxtaposer plusieurs petites informations dans un
secteur (par exemple, ajouter une lettre dans un fichier texte, word etc. ne change pas la taille d’un fichier).
De plus, pour chaque fichier créé sont indiqués entre
autres choses le type de fichier, l’utilisateur qui l’a créée (=propriétaire), la
date de la dernière modification et les droits du propriétaire, des membres du
groupe du propriétaire et du monde entier sur le fichier.
De plus le système d’exploitation permet de traduire
les informations matérielles (sur le disque dur) en informations visuelles (sur
l’écran)
Gérer les droits d’un utilisateur, c’est accepter ou refuser
de traduire l’information demandée.
Sur un smartphone, les
utilisateurs sont les applications. Nous sommes le client de ces applications.
IV Le disque dur
Il se compose d’une pile de plateaux circulaires en rotation
entre lesquels se déplacent des têtes de lecture-écriture pilotées par un bras.
Généralement en aluminium, ces plateaux sont recouverts d’une fine couche
magnétique où sont stockées et organisées les données. Chaque plateau se divise
en pistes concentriques, elles mêmes découpées en secteurs de 512 octets , récemment de 4ko chacun, chaque octet
contenant 8 bits. On appelle cluster la plus
petite unité d’espace disque occupée par un fichier et composée d’au moins un
secteur. C’est l’adresse des clusters qui donne la position exacte des données
sur le disque. Ils sont répertoriés par la table d’allocation des
fichiers (FAT) , une sorte d’index général du disque dur, qui
définit par ailleurs leur statut : disponible, réservé (occupé)
ou défectueux . Lorsqu’un cluster est déclaré disponible, le système
est autorisé à utiliser l’espace qu’il occupe. 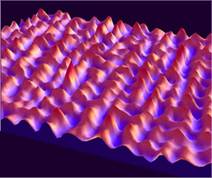

En mode écriture, la tête de
lecture-écriture équipée d’un électroaimant balaie alors la surface du plateau
de manière à générer dans ce secteur un champ magnétique local positif ou
négatif que l’on traduit, à l’intérieur de chaque bit, par 1 ou 0. Pour se
faire une idée plus précise, « vu » au microscope à force magnétique,
la surface d’un disque dur ressemble un peu à un paysage de montagnes avec des
pics magnétiques (1) et des vallées (0).